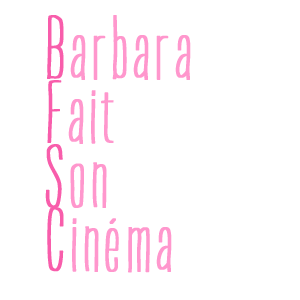Et que revoilà le cinéma américain avec l’une de ses figures fétiches : le héros. Le héros incompris, éconduit, cabossé… mais le héros qui n’abandonne jamais. Celui qui revient de loin, qui souffre, qui encaisse et à qui, au bout du récit, la victoire semble presque due. Parce qu’il l’a voulue. Parce qu’il l’a méritée. Parce qu’il l’a arrachée.
La version la plus pure, et la plus mécanique, de l’American Dream.
Et, personnellement, j’en ai soupé.
Alors oui, j’aime pourtant ce cinéma quand il est porté à incandescence. Quand ces trajectoires de revanche sont habitées, fiévreuses, traversées de zones d’ombre. Quand les personnages ne sont pas seulement des machines à vaincre mais des blocs de contradictions, de violence rentrée, de solitude. Comme chez Scorsese par exemple, chez PTA…
Là réside toute la différence : la profondeur.
Ici, tout me paraît étrangement pâle. Le film est solide, indéniablement. D’un classicisme très maîtrisé. La mise en scène est propre, la photographie élégante, superbe même par moments (love Darius Khondji !), mais rien ne déborde. Rien ne résiste.
Et peut-être que le problème vient aussi de l’incarnation.
L’acteur principal, Timothée Chalamet, donne, ça se voit. Il s’engage, il force, il pousse. Mais rien ne circule vraiment. Pas de tension organique. Pas de sueur intérieure. Pas cette sensation physique de lutte qui fait qu’un corps à l’écran devient l’incarnation d’une volonté profondément ancrée.
Ici, la souffrance reste illustrative. La fièvre ne prend pas.
Tout demeure en surface. Rien ne bouscule.
Et au fond, en reprenant depuis le début, peut-être que mon rejet vient aussi de là : de ce type de figure qu’on nous demande encore d’admirer.
En ces temps troublés, saturés de personnalités persuadées d’être au-dessus des autres, j’ai plutôt envie de récits tournés vers l’attention, le lien, l’altérité. Moins de destins nombrilistes. Plus de visages qui regardent ailleurs qu’eux-mêmes.